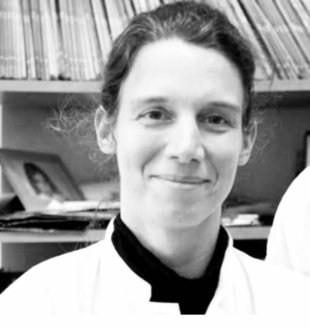Dr E. Salort-Campana : Déceler et prendre en charge la myasthénie auto-immune généralisée
Discipline : Neurologie
Date : 08/10/2024
Caractérisée par une faiblesse musculaire fluctuante, « les symptômes de la myasthénie auto-immune généralisée entraînent parfois une errance diagnostique », prévient le Dr Emmanuelle Salort-Campana, neurologue à l’hôpital de La Timone (Marseille).
TLM : Quelles sont les caractéristiques de la myasthénie auto-immune généralisée (MG) ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : La MG est une maladie auto-immune médiée par la production d’anticorps. Ces derniers perturbent le fonctionnement de la jonction neuromusculaire au niveau post-synaptique. La MG se caractérise par une fatigabilité. Il s’agit d’une faiblesse musculaire qui apparaît au cours de l’effort et fluctue au cours d’une même journée et parfois de la même heure. Elle atteint les muscles striés squelettiques. Les plus touchés sont les muscles oculaires, le muscle releveur de la paupière entraînant un ptosis (affaissement de la paupière supérieure), les muscles oculomoteurs causant une diplopie. D’autres peuvent également être atteints comme ceux de l’innervation bulbaire engendrant une dysphonie, une dysphagie et des troubles de la mastication. Les muscles des membres inférieurs et supérieurs peuvent aussi être atteints. La musculature axiale peut être affectée provoquant une camptocormie ou une tête tombante. Enfin, dans les cas les plus graves, la MG gagne les muscles respiratoires.
TLM : Quel est le profil des patients affectés en France ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : De 15 à 20 000 patients sont concernés. La MG touche des individus de tous les âges, de l’enfant au sujet très âgé. Il existe cependant deux grands pics de fréquence : chez le sujet d’environ 30 ans avec une nette prépondérance féminine et chez la personne âgée de plus de 60 ans avec une prépondérance masculine. Les femmes myasthéniques sont légèrement majoritaires. Et, dans leur globalité, les patients atteints sont de plus en plus âgés. Dans une étude épidémiologique datée de 2023, l’âge moyen des patients était de 50 ans.
TLM : Quelle est la place des auto-anticorps dans la physiopathologie ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : Les anticorps anti-récepteurs à l’acétylcholine (anti-AChR) sont majoritairement responsables de la myasthénie généralisée (chez 85 % des patients). D’autres anticorps, comme les anti-MuSK et les anti-LRP4, sont aussi présents mais concernent moins de patients. Des formes séronégatives suggèrent soit l’existence d’anticorps non encore identifiés à ce jour, soit une technique faisant défaut. Les anticorps anti- AChR exercent un effet pathogène à travers trois mécanismes : • ils se fixent sur les AChR présents sur la membrane musculaire et entrent en compétition avec l’acétylcholine en empêchant la contraction musculaire ; • par leur fixation simultanée sur deux AChR, ils entraînent leur dégradation ; • la production des anticorps anti-AChR active la voie du complément altérant la structure de la membrane musculaire et perturbant la composante post-synaptique de la jonction neuromusculaire.
TLM : Quels sont les signes cliniques inauguraux ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : En début de maladie, les signes les plus fréquents sont un ptosis et/ou une diplopie fluctuants. Cependant, tous les muscles striés peuvent être affectés avec une fatigabilité des membres, une dysphonie, une dysarthrie, une dysphagie, une atteinte des muscles axiaux et respiratoires. Certains symptômes entraînent parfois une errance diagnostique. En effet, un patient peut être adressé à un ophtalmologue pour une diplopie fluctuante ou chez un ORL pour les manifestations de dysphonie, ou encore chez un gastroentérologue pour les troubles de déglutition. Enfin, la maladie peut être diagnostiquée à l’occasion d’une décompensation respiratoire pouvant conduire le patient en réanimation. Ce peut être le cas pour certains patients n’ayant qu’un ptosis ou une diplopie passés inaperçus ou n’ayant pas consulté ou été correctement aiguillés, qui vont décompenser sur le plan respiratoire à la suite d’une d’une infection, d’une anesthésie générale ou de la prise d’un médicament contre-indiqué — les bêtabloquants ou certains antibiotiques aggravent la perturbation de la jonction neuromusculaire.
TLM : Comment diagnostiquer cette maladie ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : La recherche des auto-anticorps, l’électroneuromyogramme, le test aux anticholinestérasiques confirment le diagnostic clinique. L’imagerie thoracique (scanner le plus souvent) complète le bilan diagnostique pour rechercher une pathologie thymique associée.
TLM : Quels sont les traitements ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : L’objectif est un retour à la vie normale pour de nombreux patients. Cependant, certains patients peuvent conserver un handicap résiduel. Le traitement s’appuie sur trois composantes.
Le traitement symptomatique avec les anticholinesthérasiques (également sous forme injectable) sont des médicaments du quotidien d’une durée d’action de quatre à six heures. Un traitement de fond est nécessaire pour les nombreux patients avec une forme généralisée. Il peut comprendre des corticoïdes et/ou d’immunosuppresseurs (azathioprine, mycophénolate mofétil, rituximab). La thymectomie est indiquée en cas de thymome ou si un patient de moins de 50 ans a des anticorps anti-AChR. Enfin, les traitements de crises ou d’exacerbation regroupent les immunoglobulines polyvalentes ou des échanges plasmatiques.
TLM : Quelles sont les nouveautés thérapeutiques et leur place dans la stratégie thérapeutique ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : Deux nouvelles classes, les anti-FcRn et les anti-compléments, vont compléter l’arsenal thérapeutique. Les anti-FcRn ciblent les FcRn réduisant ainsi le taux d’IgG. Pour les patients porteurs de maladies auto-immunes médiées par les IgG, les anti-FcRn constituent une piste thérapeutique. Les essais thérapeutiques de phase III récemment publiés par ces deux classes ont montré une bonne efficacité en traitement add-on. Les patients inclus avaient une myasthénie insuffisamment équilibrée sous le traitement standard. Les deux classes ont montré une grande rapidité d’action avec une amélioration dans le mois suivant l’administration des traitements. Leur place exacte reste à être précisée dans la stratégie thérapeutique par des recommandations (certains médicaments venant d’obtenir l’AMM et d’autres étant encore en accès précoce).
TLM : Et pour les patients complexes ?
Dr Emmanuelle Salort-Campana : La filière neuromusculaire FILNEMUS est constituée de centres de référence ou de compétences dans toute la France et dans les DOM-TOM. L’AFM Téléthon et l’association l’AMIS aident les patients dans leur quotidien.
Propos recueillis
par Alexandra Sautier ■
Lire sur le même sujet notre encadré en page 101.