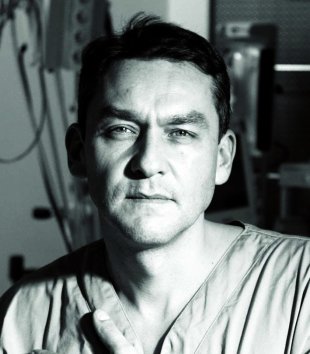Pr Fabien Saint :Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes
Discipline : Gynécologie, Santé de la Femme
Date : 10/04/2024
« La prise en charge des infections urinaires bactériennes ne nécessite généralement pas d’examens complémentaires, rappelle le Pr Fabien Saint, chirurgien urologue au CHU Amiens-Picardie.
Aucun traitement, complète-t-il, ne doit être mis en place en cas de bactéries présentes dans les urines d’un patient asymptomatique et la prescription d’antibiotiques, lorsqu’elle est jugée nécessaire, doit être limitée.
TLM : Quels sont les symptômes de la cystite simple aiguë ? Quelle en est la prévalence ?
Pr Fabien Saint : La symptomatologie associe brûlures mictionnelles (dysurie), envies fréquentes d’uriner (pollakiurie), pesanteurs pelviennes et parfois présence de sang dans les urines dans les formes sévères non traitées. L’infection urinaire peut aussi parfois se manifester par des urines foncées et/ou malodorantes. En population générale, nous observons deux pics de prévalence en fonction des tranches d’âge. Un premier pic a lieu généralement après la puberté, lors des premiers rapports et avant les premières grossesses, soit entre 15 et 25 ans. Le second pic observé concerne des femmes plus âgées, ménopausées ou en périménopause.
TLM : Comment s’établit le diagnostic ?
Pr Fabien Saint : Auparavant, un examen par bandelette urinaire à la recherche de leucocytes et de nitrites était très souvent réalisé, alors que ce test ne présente ni une bonne sensibilité ni une bonne spécificité. Cela a mené à de nombreuses prescriptions d’antibiotiques, notamment chez des femmes qui n’avaient pas de symptômes francs, alors que nous sommes aujourd’hui dans une ère de décroissance de ces prescriptions justement. C’est la raison pour laquelle, en pratique, nous tentons de limiter le recours aux examens complémentaires qui pourraient nous placer dans une situation mal adaptée. C’est un des messages que nous souhaitons faire passer avec le comité d’infectiologie de l’Association française d’urologie. La bandelette urinaire constitue un « faux ami » auquel il faut cesser de recourir ! Face à une symptomatologie franche chez une patiente qui ne présente pas d’infections récurrentes, un traitement sera mis en place.
TLM : Mais, alors, quel traitement mettre en œuvre ?
Pr Fabien Saint : Le traitement de première intention consiste en une antibiothérapie. Il repose initialement sur un sachet de fosfomycine en dose unique, qui agit rapidement en l’absence de résistance, ou la furadantine que l’on peut proposer sur des traitements courts de trois jours. Plus récemment, notre arsenal thérapeutique s’est enrichi du pivmecillinam (selexid) prescrit pour cinq jours. Très largement prescrites et connues pour leur bonne diffusion urinaire, les fluoroquinolones ne sont aujourd’hui plus indiquées en première intention, tant pour les cystites simples que pour les cystites à répétition car elles sont de grandes pourvoyeuses de résistances bactériennes. Aujourd’hui, entre 20 et 25 % des E. coli sont résistants aux fluoroquinolones ! La philosophie actuelle, en adéquation avec les recommandations nationales, européennes et internationales, c’est l’optimisation des soins. On privilégie donc les traitements courts pour réduire autant que possible le phénomène d’antibiorésistance en utilisant des molécules avec un faible niveau de résistance induit.
TLM : Y a-t-il des mesures hygiéno-diététiques à mettre en œuvre ?
Pr Fabien Saint : Le premier point essentiel est d’augmenter les apports hydriques en vue de favoriser la clairance des germes qui pourraient éventuellement se développer dans la vessie. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre par 24 heures, tous liquides confondus. Ensuite, il est important d’uriner régulièrement pour éviter la stagnation des urines et s’assurer d’une vidange la plus complète possible de la vessie. Il est parfois nécessaire de recalibrer le calendrier mictionnel de certaines patientes qui ont finalement tendance à boire correctement mais pas toujours à uriner. On observe d’ailleurs certaines populations professionnelles qui sont plus à risque que d’autres comme les caissières, qui peuvent être fixées à leur poste de travail des heures durant, sans prendre le temps d’aller aux toilettes. Les femmes ménopausées ou en périménopause peuvent parfois présenter des troubles trophiques vaginaux, qui peuvent être facilement corrigés avec une œstrogénothérapie locale (type Trophicrème ; en respectant les contre-indications).
TLM : Quand évoquer une cystite récidivante ?
Pr Fabien Saint : Définies à partir de trois épisodes par an en France, elles sont souvent multifactorielles. Les facteurs favorisants doivent être recherchés et corrigés chaque fois que possible. A la ménopause ou périménopause, par exemple, il faudra évaluer la trophicité de la muqueuse vaginale et rechercher un éventuel prolapsus qui pourrait engendrer des troubles de vidange vésicale. Dans tous les cas, les facteurs d’ordre hygiéno-diététiques doivent être évalués : hydratation insuffisante, constipation, mauvaise vidange... Dans cette indication, l’hydratation est fondamentale. A elle seule, elle permet de prévenir une bonne part des récidives de cystites.
TLM : Un traitement au long cours est-il envisageable pour ces femmes ?
Pr Fabien Saint : Lorsque l’infection récidive malgré une recherche étiologique et un traitement curatif et préventif bien mené, la mise en place d’un antibiocycle sera envisagé. Il s’agit d’une prescription d’antibiotiques (à faible pouvoir de sélection et de résistance) de manière régulière et cyclique, à raison d’une prise une fois par semaine ou tous les 15 jours pendant trois à six mois, voire plus. Ce type de traitement prophylactique permet d’éviter les réinfections, diminue les concentrations de bactéries vésicales et prévient les cystites cliniques, permettant une mise au repos de la vessie.
Propos recueillis
par Romy Dagorne ■